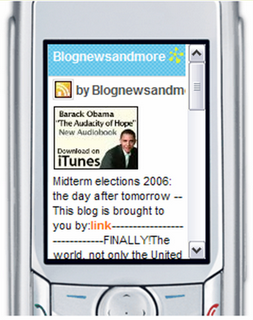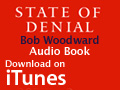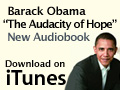France: Le Monde - Culture et présidentielle : qui propose quoi ?
Offered by:






Pour l'heure, ils n'ont encore rien dit. Dans leurs discours, les futurs candidats ont évoqué la nation, le travail, l'éducation, l'environnement, la sécurité, le chômage… Très peu la culture. Deux mesures sur les quatre-vingt-douze avancées dans les "engagements" à l'UMP. Une proposition et une affirmation chez Ségolène Royal. Bref, peu de chose.
Plus que du désintérêt, ce silence dénote un trouble. L'élaboration des programmes culturels en vue de l'élection présidentielle de 2007 ne va pas de soi : les partis politiques s'interrogent et s'entourent d'experts, comme jamais ils ne semblaient l'avoir fait jusque-là. Les candidats ne peuvent plus se contenter d'aligner quelques propositions consensuelles. Comme si, entre 2002 et 2007, des certitudes avaient été emportées et la parole libérée. La crise des intermittents du spectacle, la secousse provoquée par la loi sur le droit d'auteur sur Internet sont passées par là. Des questions taboues ont émergé : y a-t-il trop de spectacles? Trop d'artistes? Des débats ont coupé les partis en deux : comment concilier rémunération des auteurs, liberté des internautes et poids des industries culturelles? Ah, Internet! Un nouvel outil, une problématique à définir et – qui sait? – un électorat à prendre. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy l'ont compris. A sa manière, chacun a saisi la balle au bond. Des députés UMP ayant voté l'amendement légalisant le téléchargement, le ministre de l'intérieur a dû lancer une opération de charme vers le monde de la musique et du cinéma, recevant notamment les chanteurs Julien Clerc, Enrico Macias ou Calogero, les producteurs Pascal Nègre et Marin Karmitz, ou le patron de la Fnac, Denis Olivennes.
Dans ce monde plutôt acquis à la gauche, il est parvenu à susciter "le respect", voire "l'amitié", concède M.Olivennes. Le vote de la loi durcissant le dispositif contre le téléchargement (DADVSI) a été reçu par l'industrie culturelle et une partie des artistes comme une victoire. Pour consoler les internautes, l'UMP propose la "mise en ligne gratuite du patrimoine culturel français tombé dans le domaine public ou financé par fonds publics".
La présidente de la région Poitou-Charentes a emprunté le chemin inverse. "Quand j'ai fait le tour des responsables politiques en début d'année, tous m'ont reçu. C'est la seule qui a reconnu qu'elle ne connaissait pas le sujet, la seule qui ait vraiment écouté", témoigne Aziz Ridouan, 17ans, président de l'Association des audionautes, devenu son conseiller en nouvelles technologies. Un forum ouvert sur le site Désirs d'avenir, fort de 600 contributions, a permis à la candidate socialiste de trancher.
Estimant qu'il fallait "tirer parti de la numérisation et du peer to peer pour faciliter l'accès des publics aux œuvres et accroître la diversité culturelle", elle s'est prononcée pour une "diversité des sources de financement", dont la fameuse "licence globale", forfait qui légalise le téléchargement. Elle réclame aujourd'hui l'abrogation de la DADVSI. Difficile à avaler pour un PS qui s'était opposé à la licence globale. Dans l'entourage de la candidate, Jack Lang ou l'adjoint au maire de Paris chargé de la culture, Christophe Girard (PS), ne désespèrent pas de "la faire changer d'avis".
Les Verts, eux, hésitent. "Nous étions a priori favorables à la licence globale, mais la question est beaucoup plus complexe", avoue Hervé Pérard, adjoint au maire d'Evry qui anime la commission culture des Verts. Cet embarras fait ricaner le Front national. "Je ne sais pas si l'abrogation de la loi DADVSI sera proposée par la gauche, mais elle figurera à notre programme", grince Philippe Herlin, animateur du projet culturel du FN et directeur de cabinet de Marine Le Pen, qui a créé un site de téléchargement de musique classique à 1euro.
Si Internet offre un terrain presque vierge aux candidats, le reste du paysage culturel ressemble à un maquis. Comment s'y orienter, montrer à l'électeur un chemin identifiable? Pis : faire croire que l'on va – enfin – s'occuper de chantiers négligés, comme l'éducation artistique? Seuls les amis de Ségolène Royal avancent l'idée d'une demi-journée réservée aux arts à l'école, de la maternelle à l'université. Mais "elle ne l'a pas complètement validée", précisent-ils. Pour afficher sa différence, mieux vaut commencer par un symbole : rebaptiser le ministère. Lors de la convention culture de l'UMP, en janvier, Nicolas Sarkozy parlait de fusionner ministères de la culture et de l'éducation nationale, proposition disparue de l'agenda officiel, par peur d'effrayer les artistes.
"Mais s'il n'y a que quinze ministères, ça ira de soi", assure Françoise de Panafieu, animatrice de la convention culture. Le Parti communiste propose, lui, un "ministère de la culture et de l'éducation populaire", en écho à l'objectif de "démocratie culturelle". Et non pas de "démocratisation", terme trop connoté "à l'industrie culturelle, qui donne l'illusion que les produits culturels sont accessibles à tous", souligne Francis Parny (PCF), vice-président de la région Ile-de-France chargé de la culture. Quant au FN, il milite pour le retour au bon vieux "ministère des affaires culturelles" symbolisant "la rencontre entre l'artiste et le public". "Le rôle de l'Etat doit se limiter à cela. Il faut rationaliser le budget en misant sur le mécénat et les fonds privés", résume M.Herlin.
Le mécénat ne fait plus débat : personne n'entend revenir sur la loi de 2003 prévoyant d'importantes déductions fiscales aux entreprises qui investissent dans l'art. Du PS à l'UMP, on veut même le développer. Mais chacun a ses idées du financement. Offensif, le Parti communiste propose de consacrer 1% du produit intérieur brut (PIB), et non plus du budget de l'Etat, à la culture, "soit 15 milliards d'euros, en additionnant les efforts de l'Etat et ceux des collectivités locales, contre 11,5 milliards aujourd'hui". Prévoyante, l'UDF recommande "une programmation pluriannuelle" des crédits.
Lucide, Ségolène Royal estime qu'il ne suffit plus d'accorder 1% du budget à la culture, mais recommande de piocher dans tous les ministères et de "se battre" pour augmenter le budget de la politique culturelle européenne. Audacieuse, l'UMP souhaite "sanctuariser" le budget de la culture et, à rebours des pratiques qu'elle a régulièrement mises en œuvre depuis 2002, recommande d'en finir avec les crédits amputés en cours d'année.
Cela n'exclut pas les redéploiements internes. Ainsi, l'UMP avance l'idée inattendue d'une "gratuité totale dans les musées nationaux" (coût : de l'ordre de 150 millions d'euros), parmi les 92 priorités rendues publiques le 12novembre. Pourtant, elle n'était pas au programme de sa convention culture de janvier. Réticents, les élus de l'UMP se sont laissé convaincre par Emmanuelle Mignon, agitatrice d'idées du parti.
Elle dit s'être inspirée du modèle britannique et de l'exemple de Paris, où le maire socialiste Bertrand Delanoë a rendu l'accès des musées de la ville gratuit. Largement tenu à l'écart, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, ne cache pas son scepticisme.
Car comment financer une telle mesure? L'UMP a formulé une proposition choc : l'obligation de résultat en matière de mécénat. Une philosophie empruntée à l'entreprise, qui fait écho au désir du FN de "lier les subventions des institutions culturelles à la fréquentation et aux recettes propres qu'elles génèrent".
Cette musique au timbre populiste se retrouve d'ailleurs, mezzo voce, chez tous les candidats. Où il est de bon ton de dénoncer l'"élitisme culturel". Le FN propose ainsi des "comités d'usagers" dans les établissements subventionnés; les Verts préfèrent parler de "conseils artistiques" participatifs.
Quant à Ségolène Royal, elle invite les professionnels, qui "méconnaissent largement les cultures jeunes et urbaines", à considérer le "consumérisme culturel" comme "un champ à investir". En 2007, il est certain que la culture n'échappera pas au refrain ambiant du "peuple contre les élites"… Clarisse Fabre et Nathaniel Herzberg



Pour l'heure, ils n'ont encore rien dit. Dans leurs discours, les futurs candidats ont évoqué la nation, le travail, l'éducation, l'environnement, la sécurité, le chômage… Très peu la culture. Deux mesures sur les quatre-vingt-douze avancées dans les "engagements" à l'UMP. Une proposition et une affirmation chez Ségolène Royal. Bref, peu de chose.
Plus que du désintérêt, ce silence dénote un trouble. L'élaboration des programmes culturels en vue de l'élection présidentielle de 2007 ne va pas de soi : les partis politiques s'interrogent et s'entourent d'experts, comme jamais ils ne semblaient l'avoir fait jusque-là. Les candidats ne peuvent plus se contenter d'aligner quelques propositions consensuelles. Comme si, entre 2002 et 2007, des certitudes avaient été emportées et la parole libérée. La crise des intermittents du spectacle, la secousse provoquée par la loi sur le droit d'auteur sur Internet sont passées par là. Des questions taboues ont émergé : y a-t-il trop de spectacles? Trop d'artistes? Des débats ont coupé les partis en deux : comment concilier rémunération des auteurs, liberté des internautes et poids des industries culturelles? Ah, Internet! Un nouvel outil, une problématique à définir et – qui sait? – un électorat à prendre. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy l'ont compris. A sa manière, chacun a saisi la balle au bond. Des députés UMP ayant voté l'amendement légalisant le téléchargement, le ministre de l'intérieur a dû lancer une opération de charme vers le monde de la musique et du cinéma, recevant notamment les chanteurs Julien Clerc, Enrico Macias ou Calogero, les producteurs Pascal Nègre et Marin Karmitz, ou le patron de la Fnac, Denis Olivennes.
Dans ce monde plutôt acquis à la gauche, il est parvenu à susciter "le respect", voire "l'amitié", concède M.Olivennes. Le vote de la loi durcissant le dispositif contre le téléchargement (DADVSI) a été reçu par l'industrie culturelle et une partie des artistes comme une victoire. Pour consoler les internautes, l'UMP propose la "mise en ligne gratuite du patrimoine culturel français tombé dans le domaine public ou financé par fonds publics".
La présidente de la région Poitou-Charentes a emprunté le chemin inverse. "Quand j'ai fait le tour des responsables politiques en début d'année, tous m'ont reçu. C'est la seule qui a reconnu qu'elle ne connaissait pas le sujet, la seule qui ait vraiment écouté", témoigne Aziz Ridouan, 17ans, président de l'Association des audionautes, devenu son conseiller en nouvelles technologies. Un forum ouvert sur le site Désirs d'avenir, fort de 600 contributions, a permis à la candidate socialiste de trancher.
Estimant qu'il fallait "tirer parti de la numérisation et du peer to peer pour faciliter l'accès des publics aux œuvres et accroître la diversité culturelle", elle s'est prononcée pour une "diversité des sources de financement", dont la fameuse "licence globale", forfait qui légalise le téléchargement. Elle réclame aujourd'hui l'abrogation de la DADVSI. Difficile à avaler pour un PS qui s'était opposé à la licence globale. Dans l'entourage de la candidate, Jack Lang ou l'adjoint au maire de Paris chargé de la culture, Christophe Girard (PS), ne désespèrent pas de "la faire changer d'avis".
Les Verts, eux, hésitent. "Nous étions a priori favorables à la licence globale, mais la question est beaucoup plus complexe", avoue Hervé Pérard, adjoint au maire d'Evry qui anime la commission culture des Verts. Cet embarras fait ricaner le Front national. "Je ne sais pas si l'abrogation de la loi DADVSI sera proposée par la gauche, mais elle figurera à notre programme", grince Philippe Herlin, animateur du projet culturel du FN et directeur de cabinet de Marine Le Pen, qui a créé un site de téléchargement de musique classique à 1euro.
Si Internet offre un terrain presque vierge aux candidats, le reste du paysage culturel ressemble à un maquis. Comment s'y orienter, montrer à l'électeur un chemin identifiable? Pis : faire croire que l'on va – enfin – s'occuper de chantiers négligés, comme l'éducation artistique? Seuls les amis de Ségolène Royal avancent l'idée d'une demi-journée réservée aux arts à l'école, de la maternelle à l'université. Mais "elle ne l'a pas complètement validée", précisent-ils. Pour afficher sa différence, mieux vaut commencer par un symbole : rebaptiser le ministère. Lors de la convention culture de l'UMP, en janvier, Nicolas Sarkozy parlait de fusionner ministères de la culture et de l'éducation nationale, proposition disparue de l'agenda officiel, par peur d'effrayer les artistes.
"Mais s'il n'y a que quinze ministères, ça ira de soi", assure Françoise de Panafieu, animatrice de la convention culture. Le Parti communiste propose, lui, un "ministère de la culture et de l'éducation populaire", en écho à l'objectif de "démocratie culturelle". Et non pas de "démocratisation", terme trop connoté "à l'industrie culturelle, qui donne l'illusion que les produits culturels sont accessibles à tous", souligne Francis Parny (PCF), vice-président de la région Ile-de-France chargé de la culture. Quant au FN, il milite pour le retour au bon vieux "ministère des affaires culturelles" symbolisant "la rencontre entre l'artiste et le public". "Le rôle de l'Etat doit se limiter à cela. Il faut rationaliser le budget en misant sur le mécénat et les fonds privés", résume M.Herlin.
Le mécénat ne fait plus débat : personne n'entend revenir sur la loi de 2003 prévoyant d'importantes déductions fiscales aux entreprises qui investissent dans l'art. Du PS à l'UMP, on veut même le développer. Mais chacun a ses idées du financement. Offensif, le Parti communiste propose de consacrer 1% du produit intérieur brut (PIB), et non plus du budget de l'Etat, à la culture, "soit 15 milliards d'euros, en additionnant les efforts de l'Etat et ceux des collectivités locales, contre 11,5 milliards aujourd'hui". Prévoyante, l'UDF recommande "une programmation pluriannuelle" des crédits.
Lucide, Ségolène Royal estime qu'il ne suffit plus d'accorder 1% du budget à la culture, mais recommande de piocher dans tous les ministères et de "se battre" pour augmenter le budget de la politique culturelle européenne. Audacieuse, l'UMP souhaite "sanctuariser" le budget de la culture et, à rebours des pratiques qu'elle a régulièrement mises en œuvre depuis 2002, recommande d'en finir avec les crédits amputés en cours d'année.
Cela n'exclut pas les redéploiements internes. Ainsi, l'UMP avance l'idée inattendue d'une "gratuité totale dans les musées nationaux" (coût : de l'ordre de 150 millions d'euros), parmi les 92 priorités rendues publiques le 12novembre. Pourtant, elle n'était pas au programme de sa convention culture de janvier. Réticents, les élus de l'UMP se sont laissé convaincre par Emmanuelle Mignon, agitatrice d'idées du parti.
Elle dit s'être inspirée du modèle britannique et de l'exemple de Paris, où le maire socialiste Bertrand Delanoë a rendu l'accès des musées de la ville gratuit. Largement tenu à l'écart, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, ne cache pas son scepticisme.
Car comment financer une telle mesure? L'UMP a formulé une proposition choc : l'obligation de résultat en matière de mécénat. Une philosophie empruntée à l'entreprise, qui fait écho au désir du FN de "lier les subventions des institutions culturelles à la fréquentation et aux recettes propres qu'elles génèrent".
Cette musique au timbre populiste se retrouve d'ailleurs, mezzo voce, chez tous les candidats. Où il est de bon ton de dénoncer l'"élitisme culturel". Le FN propose ainsi des "comités d'usagers" dans les établissements subventionnés; les Verts préfèrent parler de "conseils artistiques" participatifs.
Quant à Ségolène Royal, elle invite les professionnels, qui "méconnaissent largement les cultures jeunes et urbaines", à considérer le "consumérisme culturel" comme "un champ à investir". En 2007, il est certain que la culture n'échappera pas au refrain ambiant du "peuple contre les élites"… Clarisse Fabre et Nathaniel Herzberg